ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES – Entre imaginaire trompeur et dangereuses analogies
Relecture critique du fanzine
« INVASION RÉBELLION »
Un contre-récit problématique
Temps de lecture estimé : 20-25 minutes
Image d’illustration, de gauche à droite et de haut en bas (photos issues du logiciel Canva) : frelon asiatique (Vespa velutina) ; arbre aux papillons (Buddleja davidii) ; mildiou de la vigne (Plasmopara viticola) ; ragondin (Myocastor coypus)
Cliquer pour naviguer
Les termes soulignés en gras facilitent la navigation.
Le sommaire vous envoie directement au chapitre choisi.
Les titres des chapitres dans le texte vous renvoient au sommaire.
Les termes dans le texte vous envoient au glossaire, et inversement.
SOMMAIRE
- À PROPOS
- INTRODUCTION
- UN CONTRE-RÉCIT PROBLÉMATIQUE
I – Une histoire de « bioxénophobie » et de complot capitaliste
II – Une histoire d’appel de la nature
III – Une histoire de solutions
IV – Une histoire de temporalité
V – Une histoire de picorage
VI – Une histoire d’interprétation
VII – Toute histoire a une fin - À L’ATTENTION DES AUTEURS ET AUTRICES
- CONCLUSION
- RESSOURCES
Annexes
Glossaire
Sources
Bibliographie - COMMENTAIRES
Légende
« Ce que propose le fanzine, retranscrit sans correction. »
Ce que nous dit la science, à travers les mots de l’auteur accompagnés par des sources.
Ce que propose l’auteur.
À PROPOS
De quoi s’agit-il ?
« Invasion Rébellion1 » est un fanzine publié en juin 2025 par le collectif « Naturalistes des Terres » (NdT), afin de proposer un contre-récit concernant les espèces exotiques envahissantes (EEE).
Ce fanzine est une compilation de points de vue distincts de plusieurs membres, il y est bien précisé qu’il n’est pas écrit dans le marbre et ne reflète pas la richesse des avis sur la question des EEE au sein du collectif.
Objectif de l’article
Proposé par l’association « ÉcoRésUrgence » (ERU) pour débattre de cette question délicate, cet article s’adresse d’abord aux auteurs et autrices du fanzine et à toute autre personne qui se sentirait concernée. Dans un second temps, il cherche à éclairer le grand public sur certains points à travers un regard critique et des sources fiables.
Certains textes reprennent des nuances et réflexions intéressantes, déjà publiées dans d’autres ouvrages, qui ne sont pas développées ici. Pour les approfondir, une bibliographie proposant différents points de vue est disponible en fin d’article.
La critique se focalise sur la manière de conceptualiser les faits et se veut volontairement synthétique dans la plupart de ses commentaires. Pour compenser cela, l’article inclut des sources et un glossaire.
La position d’ÉcoRésUrgence
ERU n’appelle pas à l’éradication systématique des EEE, elle encourage plutôt à fermer le robinet en limitant les introductions et les plantations. Elle ne lutte pas « contre », elle aspire à préserver une dynamique écologique, en cohérence avec les rythmes du vivant, et à régénérer le patrimoine génétique de nos écosystèmes, essentiel à leur résilience.
Tout comme NdT, ERU invite à repenser certains modes de gestion écologique de nos milieux anthropisés.
L’intégralité du contenu qui suit n’engage que son unique auteur.
INTRODUCTION
Je profite de l’occasion pour alerter le public sur un discours récurrent qui, par une nuance à l’apparence salutaire, peut comporter quelques risques sociaux et environnementaux.
Cette relecture critique n’est pas exhaustive et se nourrit d’une intention conciliante et constructive. Elle n’a pas pour intérêt de salir l’image de ce collectif — qui n’est pas entièrement représenté ici et mérite tout notre soutien pour le reste — mais de répondre à certains propos accusateurs et erronés qui représentent une tendance au sein de différents milieux, liés de près ou de loin au jardinage ou à l’environnement. Ce discours m’inquiète par son impact constaté sur un public néophyte et les conséquences qui en découlent, ainsi que par la tension qu’il suscite au sein de ces différents réseaux.
Étant, qui plus est, directement concerné à travers mon projet2 en faveur des espèces indigènes, il m’était difficile de laisser ce procès d’intention sans réponse.
Une réponse qui prend la forme d’une critique vulgarisée, mêlée à ma réflexion et mon ressenti.
Si je ne suis pas issu du monde scientifique, je m’y réfère largement et ma position s’appuie d’abord sur la connaissance actuelle, en considérant ses nuances et son caractère évolutif. Elle n’est donc pas immuable et n’exclut pas une part d’intuition.
Je serais ravi de corriger les erreurs que vous pourriez relever.
Ce fameux syndrome de l’imposteur désamorcé, puisse cette brève tentative aider à apaiser un clivage pesant, offrir au public quelques clés de compréhension, et recevoir un accueil humble et attentif de la part des auteurs et autrices de ce fanzine.
Pour reprendre les mots d’un inspirant et précieux ami, qui représente merveilleusement cette union entre la science et l’intuition :
« La vie est belle »
Hervé Covès, agronome, franciscain
UN CONTRE-RÉCIT PROBLÉMATIQUE
Bien que certaines informations soient sérieuses, leurs conclusions sont parfois tronquées, souvent inspirées par une littérature non spécialisée elle-même discutable.
D’après moi, c’est malheureusement une tentative maladroite : un coup d’épée dans l’eau qui a pour effet d’éclabousser un public averti et d’induire en erreur le grand public ; malgré l’intention de l’éclairer et d’élever le débat.
I – Une histoire de « bioxénophobie »
et de complot capitaliste
Si certaines motivations sont légitimes, voilà selon moi le plus gros problème de ce fanzine :
« Notre proposition est de considérer que les EEE sont des figures issues de discours réactionnaires, boucs émissaires du productivisme… »
À partir de là, il était évident que je ne serais pas le seul à tomber de ma chaise…
« … les EEE sont le bouc émissaire parfait pour détourner le regard des quatre premières causes d’effondrement de la biodiversité … »
« L’écologie capitaliste a tout intérêt à instaurer les EEE comme des ennemis à abattre. »
« Cela tient à une conception fixiste et puriste de la nature dans lequel les paysages ne changent jamais et où les espèces sont pures, « bien de chez nous » … »
« Ce mythe de la pureté spéciste a des relents racistes et nie l’hybridité et la bâtardise qui constituent les être vivants. »
« … nous ne tisserons pas plus loin le lien entre racisme et aversion pour les EEE que le seul langage employé et la stigmatisation qui en découle. »
Il faut reconnaître que le dernier extrait est subtilement formulé : comment implanter l’idée dans les esprits tout en se dédouanant. Avec tout de même pour titre : « … vont-elles nous grand-remplacer ? ».
Il y a une insistance dans la plupart des textes sur ces deux points précis, qui semblent être les fondements de la pensée de quelques membres. Jusqu’à atteindre son paroxysme :
« … « invasive species », concept inventé par Charles S Elton, un lien étroit s’inscrit dès le départ entre proposition d’un concept scientifique et présupposé raciste. La xénophobie de son auteur, son obsession pour la pureté des races ne sont hélas qu’un reflet des idéologies à l’œuvre dans le milieu académique britannique du XIXe siècle. »
Pour oser publier une accusation aussi grave sur un défunt il faut disposer de preuves solides, ce qui n’est pas le cas. Il n’existe visiblement aucune source allant dans ce sens. Pouvons-nous alors parler d’atteinte à la mémoire ? Ce qui n’est pas anodin…
Sommes-nous toujours dans une simple mésinformation ici ? Une telle précision dans l’erreur pose question… et ne laisse pas de doute quant à l’interprétation possible par un public sensible non averti.
Cette association à la xénophobie et cette allusion au complot capitaliste sont inappropriées et révèlent soit des lacunes scientifiques, soit une approche trop intuitive ; dans les deux cas c’est une position délicate et plutôt illégitime pour traiter un sujet aussi complexe.
On ne peut que regretter l’atmosphère idéologique dans laquelle nous plonge une partie de ce fanzine, elle cause beaucoup de tort au reste par son ampleur tout au long de la lecture.
Commençons par rappeler que l’exotisme en soi n’est pas le problème : la plupart de nos fruits et légumes sont d’origine exotique et personne ne remet en question leur présence — car ils n’ont pas d’impact sur nos écosystèmes, et sont délicieux. Tout comme de nombreuses autres plantes ornementales qui, bien qu’elles ne présentent que peu d’intérêt pour la biodiversité, ne sont pas pour autant envahissantes.
L’idée même de haïr une espèce végétale ou animale pour ses origines géographiques peut sembler saugrenue… Ce n’est pas pour nous, humains, mais pour les écosystèmes et la biodiversité locale que ces plantes sont « mal venues ».
En règle générale, l’être humain a toujours été fasciné par l’exotisme — un commerce juteux pour le capitalisme — ce qui, à notre époque, devient réellement problématique.
Il n’y a rien de xénophobe à penser que les cactus ou les dromadaires ne sont pas à leur place en Antarctique, il est simplement question d’adaptation, de coévolution3 et de mutualisme interspécifique.
Bien que cela semble moins évident pour le reste du vivant, c’est un principe fondamental en écologie. Évitons l’anthropomorphisme : le vivant ne peut être « citoyen du monde » car il est avant tout lié à un écosystème, qui n’est pas considéré sans mouvement. Si la migration des espèces existe depuis la nuit des temps, les transports humains ont considérablement perturbé cette dynamique fragile. Faudrait-il les compter comme des vecteurs naturels ?
« Nous invitons … à ne pas laisser le système capitaliste polluer nos imaginaires, à ne pas faire confiance aux catégories qu’il créé pour accumuler du capital … »
Ne nous écartons pas de la réalité en confondant science et capitalisme, et n’oublions pas de rappeler que cet exotisme est avant tout le capital de l’horticulture ornementale. De toute évidence, le buddleia (Buddleja davidii « arbre aux papillons ») se vend mieux que le sureau noir (Sambucus nigra).
La science nous éclaire, tandis que ce contre-récit — aussi bien intentionné soit-il — risque d’alimenter la confusion chez le grand public par manque de rigueur et de complétude, bien plus qu’il ne va répondre à l’objectif initial : nourrir la réflexion des acteurs impliqués — plutôt pris pour cibles ici.
Je crains que cette approche soit écologiquement et socialement contre-productive.
II – Une histoire d’appel de la nature
Malgré leur introduction d’origine anthropique, cette idée séduisante fait son chemin :
« … accuser la renouée du Japon d’être une peste, « c’est en quelque sorte accuser son thermomètre quand on a de la fièvre ». »
Cette hypothèse est fondée sur une approche reconnue : la bio-indication des plantes par la levée de dormance. Selon cette approche, les plantes sont — dans une certaine mesure — révélatrices de l’état de santé du sol, lequel favorise ou non la germination à travers différents facteurs — physiques, chimiques, biologiques, thermiques, hydriques.
Seulement, cette conclusion n’est-elle pas discutable lorsque l’on considère le caractère clonal4 de l’espèce (Fallopia japonica) ? Ce qui implique une multiplication végétative excluant la germination.
C’est une question essentielle qui n’a visiblement pas encore trouvé de réponse unanime en pédologie.
La nuance est toujours bienvenue — elle est même appréciée — prenons garde néanmoins à ne pas sacrifier la rigueur sur l’autel de l’intuition. Les impacts négatifs sont bien documentés — particulièrement sur cette espèce — et non négligeables.
Si en milieu anthropisé ces espèces pionnières auront souvent l’avantage, cela ne signifie pas pour autant qu’aucune espèce indigène n’aurait réussi à s’implanter ; ont-elles seulement encore une chance ? Quand les villes sont majoritairement agrémentées d’exotiques, faut-il s’étonner de voir leur descendance dominer les alentours ?
Pour ma part, je crois que la nature est avant tout opportuniste et s’équilibre ensuite, sans pour autant exclure l’influence des différents facteurs du milieu.
Quant à l’immunité écologique, ne faut-il pas d’abord la chercher dans le patrimoine biologique d’origine, capable d’apporter une réponse holistique incluant la biocénose ?
III – Une histoire de solutions
« Pourtant les EEE … ont bel et bien pour d’autres spécialistes un impact positif et apportent avec elles un nouveau tissu de relations : cachette, nourriture, ressource, espèces associées. »
Deux questions se posent — et s’imposent — ici :
- Cet impact positif est-il dû à une caractéristique unique, absente de la flore autochtone ?
- Ces relations sont-elles équivalentes en termes de quantité, de qualité, et surtout de diversité ?
Quant aux espèces associées, la grande majorité est restée dans l’aire géographique d’origine, c’est d’ailleurs l’un des facteurs de leur expansion : l’absence de régulateurs naturels dans leurs milieux d’introduction.
Évitons de glisser vers des biais de confirmation :
Malgré des bénéfices épars et relatifs à des contextes bien particuliers5, les études mettent surtout en évidence la rareté de ces relations.
Ce qui semble avoir du sens lorsque l’on on considère la lente coévolution des espèces.
Ne nous laissons pas tromper par le premier insecte venu butiner une plante exotique et rappelons qu’avoir du monde au bar ne garantit pas la qualité du service.
C’est le cas du buddleia6, ce faux ami des pollinisateurs — qui les attire fortement pour leur proposer un nectar de moindre qualité — suscite très peu d’intérêt chez le reste des invertébrés. La flore autochtone voit alors ses pollinisateurs détournés, au détriment de son brassage génétique et donc de sa résilience. S’ajoute à cela la perte de gîtes, de couverts et de lieux de reproduction pour la faune inféodée.
Un cercle vicieux pour l’ensemble de la biodiversité.
IV – Une histoire de temporalité
« À ce titre le discours sur les EEE est dangereusement présentiste et n’intègre pas le fait que nos milieux sont déjà le fruit d’hybridations entre espèces allochtones et autochtones. »
« … cette approche court-termiste ne prend pas en compte la complexité des dynamiques écologiques contemporaines. »
Ne serait-il pas plus juste ici de parler directement de mondialisation ?
Cette approche n’est ni présentiste ni court-termiste ; elle repose justement sur l’histoire évolutive des dynamiques écologiques et met pertinemment en évidence les écarts colossaux dans leurs impacts sur les écosystèmes.
Cette dynamique exponentielle est strictement anthropique et ne respecte aucune règle ou limite écologique. Elle est clairement identifiée et se trouve au cœur de la réflexion :
L’activité humaine7 est le principal déclencheur de cette explosion migratoire, notamment via le commerce international moderne.
À l’inverse, la migration originelle emprunte les trames écologiques8 et reste limitée par des barrières géographiques naturelles — montagnes, océans, déserts…
Ce processus naturel d’hybridation des milieux, très lent, permet à l’ensemble du vivant de s’adapter progressivement aux transformations écologiques — rien de comparable avec la brutalité des dynamiques actuelles.
V – Une histoire de picorage
Essayons de ne pas succomber au « Cherry picking » : ne sélectionner que ce qui nous convient.
« Les ragondins se multiplient car leurs prédateurs ont été retirés de nos milieux, l’exclusion du « nuisible » renard permet l’apparition du « nuisible » ragondin. »
Les prédateurs naturels du ragondin dans son milieu d’origine sont le puma et le caïman, nous ne disposons pas d’équivalent en France. Les rares prédateurs opportunistes comme le renard s’attaquent principalement aux jeunes individus, pas de quoi réguler la population. C’est le commerce de la fourrure qui a permis l’apparition du ragondin9.
« … îles et atolls, sont particulièrement vulnérables à l’arrivée de chiens, chats et rats, trois espèces qui font porter le chapeau à toute une série d’organismes étiquetés comme invasifs … »
C’est justement dans ces milieux insulaires que les EEE font le plus de dégâts, faisant disparaître définitivement de nombreuses espèces endémiques. Elles ont joué un rôle dans 86 % des extinctions connues10. Et ce ne sont certainement pas que des chiens, chats et rats.
« La renouée du Japon n’envahit pas les forêts primaires … ou même les vieilles ripisylves …Elle prend de la place là où nous avons déstabilisé les milieux … »
C’est le propre d’une espèce pionnière de ne pas s’installer en forêt, ni en ripisylve dense et bien établie, et de s’installer plutôt en milieu perturbé — il n’existe d’ailleurs qu’une seule forêt primaire en Europe, située en Pologne. Dans ces milieux, elle prend la place des espèces pionnières indigènes — ronce, sureau noir, aubépine, bouleau… — malheureusement impuissantes face à sa phénoménale supériorité11.
« L’ailante quant à elle, a été plantée dans les villes pour assainir l’air … »
L’ailante (Ailanthus altissima) a été introduit en France à des fins ornementales12. D’après le guide de Guillaume Fried (voir bibliographie), c’est le cas pour plus de 50 % des espèces végétales invasives.
« Les frelons asiatiques prolifèrent du fait de la quantité astronomique de ruches d’abeilles sélectionnées pour être dociles … »
Tout dépend de l’endroit. Leur régime alimentaire ne s’arrête pas à l’abeille domestique, loin de là. Par exemple, dans une étude13 sur 16 colonies : environ deux tiers de leur régime étaient constitués de plus de 150 espèces d’arthropodes — principalement des insectes.
VI – Une histoire d’interprétation
« Il y aurait aussi eu à dire sur ces espèces non-exotiques mais pour autant toujours classées comme invasives (les moustiques, les ronces etc.) »
Ces espèces ne sont pas « classées comme invasives », elles sont simplement « considérées parfois envahissantes dans nos espaces privés ». La nuance est importante : aucun problème avec elles dans la nature.
« … en cherchant à détricoter ce terme parapluie qui regroupe des réalités diverses, des modalités d’introduction et des comportements spécifiques … »
Ce type de formulation peut prêter à confusion : peu importe la diversité de ces réalités, elles répondent toutes à la définition « espèce exotique envahissante », loin d’être un terme parapluie.
Les erreurs de langage sont fréquentes dans les milieux non spécialisés, la définition elle, reste très précise :
Une EEE est une espèce introduite par l’humain, volontairement ou involontairement, sur un territoire hors de son aire de répartition naturelle, et qui menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales.
« … c’est bien la destruction des milieux naturels, la pollution et les changements climatiques qui permettent l’installation et la prolifération d’espèces exotiques envahissantes. »
On ne peut prétendre connaître le sujet en se contentant de si peu d’éléments.
Comme dans de nombreuses publications faisant l’éloge des EEE, dans ce fanzine — sauf erreur de ma part — il n’est fait mention nulle part des diverses raisons connues par la science pour expliquer de telles expansions :
Allélopathie, capacité de germination, compétitivité racinaire, polyploïdie, gigantisme, plasticité phénotypique, absence de régulateurs, croissance et vigueur exceptionnelles, capacité de photosynthèse…
Autant de facteurs qui leur offrent une génétique particulièrement compétitive face à la flore autochtone qui — faute d’avoir coévolué avec ces nouvelles venues — est souvent dépourvue de réponse adaptée.
VII – Toute histoire a une fin
« Nous aurions voulu parler … avec des personnes dont le métier les fait interagir quotidiennement avec ces espèces, entendre des discours naturalistes et militants qui rentre en friction avec le notre et nous mettent à l’épreuve. »
C’est interpellant… Il faut reconnaître que la démarche était osée, il faut bien cela parfois.
J’espère alors répondre en partie à cet appel un peu tardif.
« Un problème bien connu des chercheurs, c’est qu’on ne trouve que ce que l’on cherche. »
Cet extrait est parfait pour résumer et clore cette relecture.
Quelques chiffres14 issus du rapport de l’IPBES :
– 37 000 espèces exotiques introduites dans le monde par les activités humaines
– 200 nouvelles espèces exotiques enregistrées chaque année
– 3 500 espèces exotiques ont des impacts négatifs documentés dans la littérature
– impliquées dans 60 % des extinctions globales d’espèces documentées, dont 90 % ont eu lieu dans les îles, et dans près de 1215 extinctions locales
– elles ont des incidences négatives sur la qualité de vie dans 85 % des cas étudiés
À L’ATTENTION
DES AUTEURS ET AUTRICES
« … on est jamais à l’abri d’une saison 2 »
Afin de préparer au mieux cette possible deuxième saison, je vous invite à prendre connaissance des sources accompagnant cet article. Ainsi, vous pourriez peut-être ajuster votre position.
On peut aussi prendre le problème des plantes exotiques envahissantes à la racine : est-ce à cause des arbres ou du mégot de cigarette que la forêt brûle ?
Le récent cours15 de Franck Courchamp — membre de l’IPBES16 — sur les invasions biologiques, apporte les bases scientifiques — et bien plus encore — pour appréhender la question avec un regard plus précis.
Ce cours est une opportunité pour mettre votre discours à l’épreuve — comme vous le souhaitiez — et peut-être aboutir à un erratum. Ce serait selon moi un message fort, témoignant d’une volonté de faire avancer le débat tout en éclairant son public — au-delà des sentiments et des convictions personnelles. Un gage d’honnêteté et d’objectivité pour une écologie qui mérite toute notre rigueur.
J’espère que vous comprenez ma motivation, ma démarche est bienveillante et désintéressée.
Votre engagement au sein de ce collectif est honorable et vos intentions sont nobles, ne laissons pas ces divergences — relativement marginales dans la cause écologiste — nous diviser. À cette époque chargée d’atteintes au vivant, je crois qu’il convient d’unir nos forces.
CONCLUSION
Dans tout ce que la nature opère,
Jean-Baptiste DE LAMARCK, naturaliste, XVIIIᵉ
elle ne fait rien brusquement.
Lorsque l’on vient défendre un « accusé », il convient de commencer par étudier les preuves à charge ; or, il est évident qu’ici des lacunes fondamentales nuisent au jugement, et les « crimes » imputés sont remis en question sans jamais prendre pleinement connaissance du dossier.
Le recul nous amène à constater les conséquences d’un tel discours.
D’abord, il alimente un clivage en accusant injustement des millions de personnes qui défendent l’environnement de manière sincère, et de surcroît, en connaissance de cause.
Ensuite, il décrédibilise un discours essentiel en faveur d’une diversité génétique indigène, au risque d’augmenter l’attrait du public pour les espèces exotiques non envahissantes, et leurs nombreuses variétés horticoles. Si ce n’est pas un drame en soi, c’est néanmoins un réel manque à gagner pour la biodiversité.
Il n’est pas non plus question de renoncer au moindre bégonia, mais il me semble que faire un compromis entre plaisir personnel et nécessité pour la biodiversité n’est pas déraisonnable à notre époque.
Rappelons que ces plantes…
- déracinées de leur écosystème d’origine
- arrachées à leur cortège biologique
- détournées de leur rôle écologique
- transformées génétiquement
- introduites sous un climat étranger à leur phénologie
- implantées en remplacement de la flore indigène dont dépendait la faune
…viennent avant tout de nos parcs et jardins. Des paysages artificiels transformés principalement pour un effet visuel, agrémentés de créations humaines biologiquement inadaptées à la faune. Mais extraire des EEE, dans un lieu public ou ailleurs, pour préserver une nature sauvage en plein effondrement ? On appelle cela un « crime écologique »…
Considérant tout cela, on est en droit de se demander : où et quand a eu lieu le point de bascule ?
Ne devrions-nous pas fixer des limites à la domestication du vivant ?
La nature, pour être commandée, doit être obéie.
Francis BACON, scientifique, philosophe, XVIIᵉ
Parce que planter un arbre ne suffit pas : il faut choisir le bon.
Pour répondre aux besoins de l’ensemble de la biodiversité, qui en échange continuera de nous fournir ses services écosystémiques, il vaut mieux se tourner vers la marque de l’OFB : « Végétal Local17 ».
Elle repose sur une démarche rigoureuse pour permettre à la flore sauvage et locale — géographiquement distincte — de continuer son brassage génétique naturel. Un processus essentiel pour favoriser sa diversité, clef de son adaptation face au changement climatique, de sa résilience et de sa robustesse. Pendant que l’horticulture ornementale privilégie l’apparence à l’appartenance, ne permettant plus à ses variétés de jouer leur rôle écologique.
Dans la vie sauvage repose la sauvegarde du monde.
Henry David THOREAU, philosophe, naturaliste, poète, XIXᵉ
S’il est une question essentielle dans tout projet de végétalisation à visée écologique, c’est celle de la génétique, au-delà du simple choix de l’espèce ou de la variété.
Enfin — et c’est le plus important — ce discours amène parfois à planter des EEE comme acte subversif de rébellion écologique, pensant qu’elles ne s’installeront qu’à des fins réparatrices. Ce qui rendrait l’acte salvateur.
Bien qu’aucune étude scientifique ne vienne valider cette hypothèse, de nombreuses personnes en ont fait aujourd’hui une règle d’or, oubliant le reste de l’équation.
Il ne peut exister de théorie valable,
Walt WHITMAN, poète, XIXᵉ
à moins qu’elle ne corrobore celle de la Terre.
Il devient habituel de voir ce sujet involontairement détourné et mal traité. On part d’une observation scientifique intéressante, pour parfois finir en dogme politique qui a pour principal effet de polariser les opinions et diviser les rares forces vives de la cause environnementale. Je reste convaincu qu’il y a mieux à faire.
Dans toutes les professions,
Marc-André Selosse, biologiste
ce sont ceux qui se remettent en question
qui réussissent le mieux.
Cultivons notre curiosité et notre esprit critique
Droits d’auteur
Afin de respecter la propriété intellectuelle de l’auteur, ce texte est sous licence CC BY-NC-ND 4.0 :
– Toute reproduction est autorisée à condition de citer l’auteur.
– Toute modification, traduction, adaptation ou résumé est interdite sans autorisation de l’auteur.
Pour en savoir plus, cliquer sur le logo ci-dessous.
RESSOURCES
Annexes
Les enjeux pour la biodiversité locale – OFB
Espèces invasives – Jonathan Dumas
Chronique du vivant – Marc-André Selosse
« Marc-André Selosse, dans sa « chronique du vivant » en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle, nous met en garde contre les replantations d’arbres exotiques. »
La migration assistée des arbres – ONF
« Pour adapter les forêts aux changements climatiques, les équipes de l’ONF ont initié en 2011 une expérience de migration assistée des essences baptisée projet Giono. Depuis maintenant plus de dix ans, des graines de diverses provenances sont sélectionnées dans le Sud de la France pour germer à la pépinière de Guémené- Penfao (Loire-Atlantique), et enfin être plantées en forêt de Verdun (Meuse). »
La pause Biodiv’ – Arthropologia
Les invasions biologiques – Franck Courchamp
Invasion Rébellion – Naturalistes des Terres
Glossaire
Brassage génétique : recombinaison naturelle des gènes lors de la reproduction, favorisant la diversité génétique et l’adaptation des espèces.
Allélopathie : interaction biologique où une plante libère des substances chimiques qui freinent ou inhibent la croissance des espèces voisines.
Biocénose : ensemble des êtres vivants coexistant et interagissant dans un même habitat ou écosystème.
Bio-indication : utilisation d’espèces vivantes pour évaluer l’état ou l’évolution d’un environnement.
Coévolution : évolution conjointe de deux espèces qui s’influencent réciproquement (ex. plantes et pollinisateurs).
Cortège biologique : ensemble des espèces animales, végétales ou microbiennes associées à une espèce ou un milieu donné.
Dynamique écologique : ensemble des changements et interactions d’origine naturelle qui modifient les écosystèmes dans le temps.
Endémique : espèce limitée à une aire géographique restreinte (île, montagne, région précise).
Espèce associée : espèce qui vit, se nourrit ou se reproduit en lien étroit avec une autre espèce particulière.
Espèce exotique envahissante : espèce lointaine introduite par l’humain qui se propage rapidement et perturbe les écosystèmes locaux (onagre, moustique tigre, écureuil gris).
Holistique : approche globale d’un système qui prend en compte l’ensemble des interactions entre ses différentes parties.
Indigène/autochtone : espèce native, présente naturellement dans une région sans intervention humaine (≠ exotique/allochtone).
Inféodée : espèce qui dépend fortement d’un habitat, d’une ressource ou d’une autre espèce.
Invasion biologique : prolifération d’une espèce exotique, introduite par l’humain, qui perturbe les écosystèmes locaux.
IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (équivalent du GIEC pour la biodiversité).
Levée de dormance : germination d’une graine après une période d’inactivité, suite à des facteurs (chocs) externes.
Milieu anthropisé : environnement modifié ou transformé par les activités humaines (parcelle agricole, jardin public, zone urbaine…).
Milieu perturbé/dégradé : habitat naturel altéré par des facteurs externes, souvent d’origine humaine (urbanisation, pollution, surexploitation…).
Multiplication végétative : reproduction asexuée, à partir d’organes sans graine (rhizomes, tiges, stolons…), donnant des clones.
Mutualisme interspécifique : interaction durable entre deux espèces différentes où chacune tire un bénéfice.
OFB : Office Français de la Biodiversité
Patrimoine génétique : ensemble de la diversité génétique d’une espèce ou d’un territoire, clé de sa résilience.
Phénologie : étude des rythmes saisonniers du vivant en lien avec le climat (floraison, migration, chute des feuilles).
Pionnière : espèce capable de coloniser en premier des milieux dégradés ou nus, préparant le terrain pour d’autres.
Plasticité phénotypique : capacité d’une espèce à modifier son apparence ou son fonctionnement en fonction de l’environnement.
Polyploïdie : présence de plusieurs jeux complets de chromosomes dans une cellule, ce qui peut favoriser vigueur et adaptation.
Résilience : capacité d’un écosystème à absorber un choc et à se rétablir après perturbation.
Ripisylve : végétation arborée bordant les cours d’eau, jouant un rôle écologique important.
Services écosystémiques : désignent les bienfaits produits par la nature pour l’environnement et la société (ex. nourriture, climatisation, loisirs…).
Trame écologique : réseau d’espaces naturels connectés permettant les déplacements et la survie des espèces.
Variété horticole : plante sélectionnée génétiquement par l’humain pour répondre à divers besoins (ex. esthétique, goût, calibre…).
Sources
1 : Collectif « Naturalistes des Terres », 2025
« Invasion Rébellion »
https://cryptpad.fr/file/#/2/file/czALP5kJspjQXiYj+Nkfz7uU
2 : Association « ÉcoRésUrgence », 2025
« Recherche Terre Pays Basque »
https://ecoresurgence.org/recherche-terre-pays-basque/
3 : Collège de France, 2024
« Coévolution entre les plantes à fleurs et leurs pollinisateurs »
https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/cours/interactions-plantes-pollinisateurs-hier-aujourd-hui-et-demain/coevolution-entre-les-plantes-fleurs-et-leurs-pollinisateurs
4 : École Normale Supérieure de Lyon – Département de biologie, 2011
« De l’origine du succès de la renouée du Japon »
https://biologie.ens-lyon.fr/ressources/Biodiversite/Documents/la-plante-du-mois/la-renouee-du-japon-a-la-conquete-du-monde#:~:text=
5 : Office Français de la Biodiversité, 2023
« Les espèces exotiques envahissantes : enjeux et impacts »
https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Plaquettes et rapports instit/eee-enjeux-impacts.pdf
6 : Espèces Exotiques Envahissantes – Centre de ressources, 2024
« Évaluer les impacts environnementaux des plantes exotiques envahissantes – Premières avancées du projet Clever en Nouvelle-Aquitaine »
https://especes-exotiques-envahissantes.fr/evaluer-les-impacts-environnementaux-des-plantes-exotiques-envahissantes-premieres-avancees-du-projet-clever-en-nouvelle-aquitaine/
7 : L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature – Comité français, 2024
« Les espèces exotiques envahissantes : un défi écologique et économique mondial »
https://uicn.fr/wp-content/uploads/2024/10/fiche-decryptages-les-especes-exotiques-envahissantes-un-defi-ecologique-et-economique-mondial.pdf
8 : Trame Verte et Bleue – Centre de ressources
« Définitions de la Trame verte et bleue »
https://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue/definitions-trame-verte-bleue
9 : Espèces Exotiques Envahissantes – Hauts de France, 2015
« La colonisation de la Somme par le Ragondin (Myocastor coypus), mammifère exotique envahissant. Synthèse des connaissances et impacts sur la flore et les végétations palustres. »
https://eee.drealnpdc.fr/wp-content/uploads/2021/01/Art_Bull_SLNP_2015_RCRFRagondin_Colonisat°_SommeImpact_Flore.pdf
10 : Le Courrier de l’UNESCO, 2021
« Les îles, fragiles vitrines de la biodiversité »
https://www.unesco.org/fr/articles/les-iles-fragiles-vitrines-de-la-biodiversite-0
11 : Agence de l’Eau – Seine-Normandie, 2017
« Synthèse bibliographique sur le caractère invasif des renouées asiatiques et sur les méthodes de gestion de ces plantes »
https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Synthese_renouee.pdf
12 : Archives ouvertes HAL, 2009
« Que savons-nous de l’ailante ? Ailanthus altissima (Miller Swingle) »
https://hal.science/hal-00473267v1/document
13 : Muséum National d’Histoire Naturelle, 2021
« L’abeille domestique n’est pas la seule proie du frelon asiatique »
https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-abeille-domestique-n-est-pas-la-seule-proie-du-frelon-asiatique?utm
14 : Espèces Exotiques Envahissantes – Centre de ressources, 2023
« Chiffres clés – Mondial »
https://especes-exotiques-envahissantes.fr/chiffres-cles/#:~:text=
15 : Franck Courchamp, « Sciences de la vie – Collège de France », 2025
« Les invasions biologiques »
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOj9pZ2YNGZ92bxeVxlI8wbkxalTBc3sc
16 : Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité
« IPBES »
https://www.fondationbiodiversite.fr/la-frb-en-action/nos-implications/ipbes/
17 : Végétal Local
« La biodiversité prend racine »
https://www.vegetal-local.fr
Bibliographie
« La Société Botanique de France », 2021
« Livre blanc sur l’introduction d’essences exotiques en forêt »
https://societebotaniquedefrance.fr/livre-blanc-sur-lintroduction-dessences-exotiques-en-foret/
Guillaume Fried, éd. Belin, 2017
« Guide des plantes invasives »
Hugues Demeude, éd. Michalon, 2017
« Alerte aux fléaux biologiques »
Gilles Clément, éd. Nil, 2002
« Éloge des vagabondes »
Thierry Thévenin, éd. Lucien Souny, 2021
« Les plantes du chaos »
Jacques Tassin, éd. Odile Jacob, 2014
« La grande invasion »
COMMENTAIRES
Cet espace est ouvert pour permettre le débat,
sous réserve de validation des commentaires par la modération.
Les échanges doivent se dérouler dans le respect et la courtoisie.
Nous encourageons le partage d’informations vérifiables en ligne.
Un système d’évaluation est disponible pour vous permettre
d’exprimer rapidement votre impression sur cet article.
Vos retours nous offriront une visibilité sur sa réception
et nous encourageront, ou non, à renouveler l’expérience.
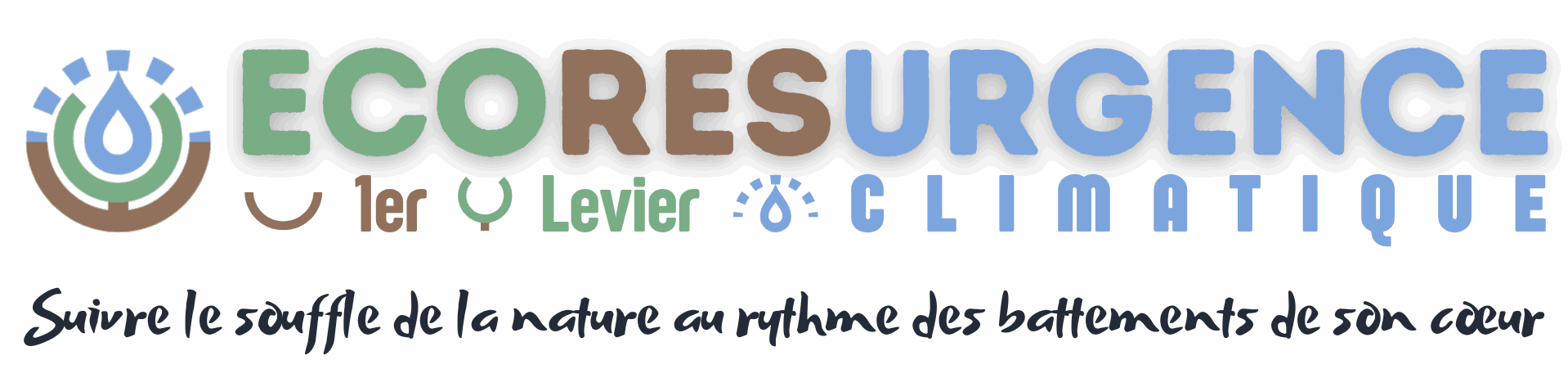

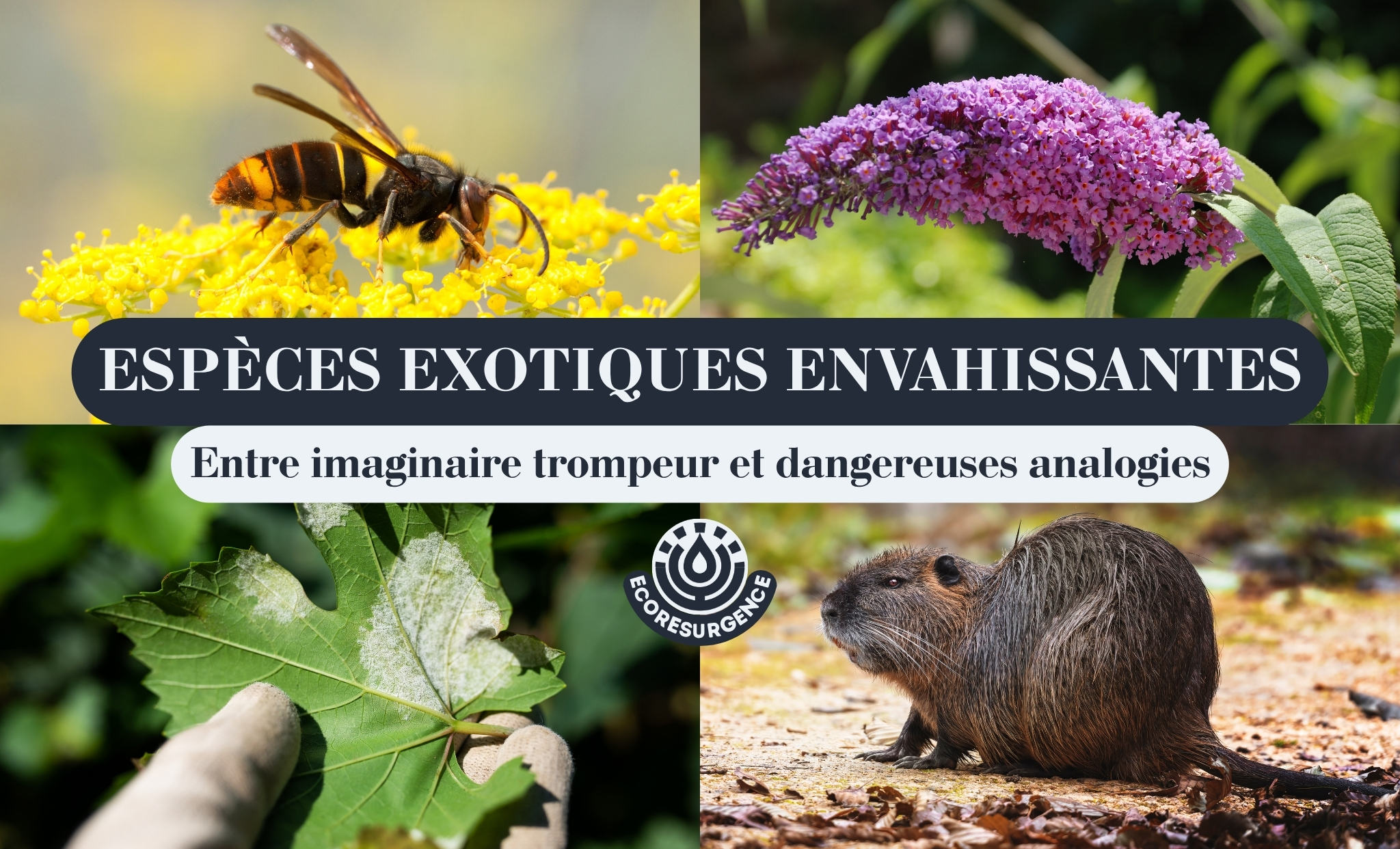
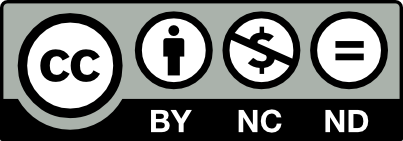
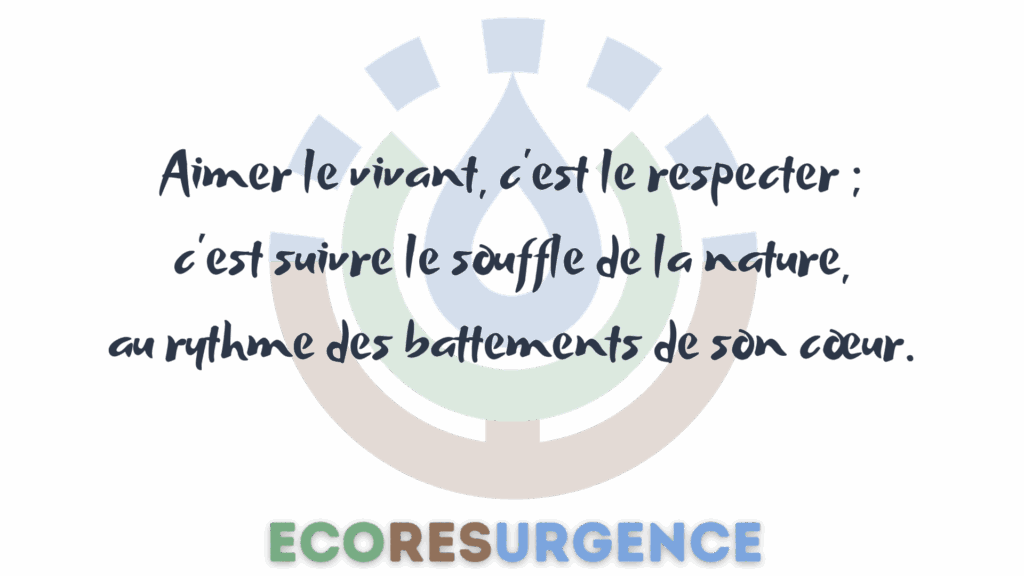
Bravo pour votre article, qui replace le sujet dans son juste contexte. Il ne s’agit pas de lutter « contre » l’exotisme, mais bien de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous inscrire dans des continuités écologiques et environnementales, sans chercher à contrôler ou dominer l’ensemble du vivant. Concernant l’Ailante, il me semble intéressant de rappeler qu’au-delà de son usage ornemental (pour remplacer les tilleuls dans les parcs et avenues urbaines) cette espèce a aussi été introduite avec un objectif économique : l’ailante servait de plante-hôte pour l’élevage du Bombyx de l’ailante (Samia cynthia), un papillon lui aussi déplacé hors de son aire d’origine pour produire une soie alternative, appelée ailantine. Ce cas illustre parfaitement comment des décisions motivées par des enjeux économiques et globaux ont pu involontairement favoriser l’implantation d’espèces qui malheureusement n’avaient rien demandé à personne…
Bonjour Madeleine,
Merci pour votre commentaire et ce rappel concernant l’ailante.
Bonjour,
et merci d’apporter un contre récit à ce contre récit. L’impression qu’on manque cruellement d’espaces de dialogue pour partager ses idées, qui resteront des idées quoiqu’on en dise, il ne peut y avoir de dogme ou de vérité universelle, on trouvera toujours un exemple pour soutenir notre idée et démonter celle de ses opposants.
Je regrette que la première version de cet article ne traite pas des questions culturelles liées aux plantes et aux paysages. On constate notamment dans le sud de la France un fort engouement pour les plantes exotiques de la part des citoyen.nes, parce qu’on nous les « vend » plus jolies, plus adaptées aux changements globaux. Il faut que nos paysages ressemblent à telle carte postale, correspondent à un objectif de performance biologique et esthétique, légitimant ainsi ces exotiques censées faire le taf bien mieux que nos pauvres plantes locales. Ces postures cachent énormément de sales réflexes d’occidentaux colonisateurs et dominateurs, convaincus de leur toute puissance sur leur environnement, au point de venir planter volontairement des exotiques en plein massif, parfois à 2h de marche du premier parking. Le tout sans se soucier du statut foncier des terrains, de leur vocation, etc.
Car oui, l’autre point peu traité dans cet article, c’est le rôle sous estimé des plantations volontaires, sous couvert « d’aider la nature » ou de « faire joli » (sous entendu parce que la nature ne l’est pas assez, n’en est pas capable seule). Attitude au mieux naïve teintée d’ignorance, sinon paternaliste teintée d’ingérance. Ce sont littéralement des foyers de dispersions en pleine nature, difficile à détecter au début, et quand il le sont, c’est souvent trop tard.
Le combat à mener serait alors non pas seulement contre le béton et l’artificialisation des terres, mais aussi contre la banalisation culturelle, l’uniformisation des pensées, la perte des savoirs locaux, la perte d’empathie pour une flore locale jugée pas assez performante (dans le sens capable de nous émerveiller autant que de nous être « utile » sur les plans matériels…). Une ré-éducation nécessaire donc, qui passe par la transmission des savoirs naturalistes, des mises en récit plus intimes avec le vivant, moins scientifisées, moins élitistes et excluantes. Et peut être alors, en fédérant au lieu de diviser, on arrivera à quelque chose de beau ?
Bonjour Ajuga,
Ravi de vous offrir l’opportunité de vous exprimer, bien que je doute que la portée soit à la hauteur de l’importance du débat.
Pour ce qui est de la vérité, de mon point de vue elle ne peut qu’être unique, mais pas immuable. Elle est interprétée, et sans doute plus complexe que nous le pensons.
Merci pour votre commentaire qui met le doigt sur des points essentiels, que j’ai préféré me contenter d’effleurer ici par crainte d’alourdir le contenu. J’ai bien d’autres choses à dire… c’est que ce sujet des EEE mérite plus qu’un simple article, nous serons d’accord là-dessus je pense.
Cet attrait pour l’esthétique exotique est responsable d’une perte non négligeable du patrimoine biologique local, c’est indéniable. Et la solution exogène pour répondre aux changements globaux est bien trop chargée de risques et d’incertitudes. Je ne peux que rejoindre vos arguments. Je laisse tout de même une fenêtre ouverte pour entendre le vent tourner au bon vouloir du changement climatique, tout autant chargé d’incertitudes.
Le combat que vous proposez est celui que je compte mener à travers cette association et son projet de pépinière participative, vous le définissez merveilleusement ici. Merci de m’y encourager !
Je suis convaincu que fédérer à travers de l’action et du palpable sera bien plus efficace que cet article.