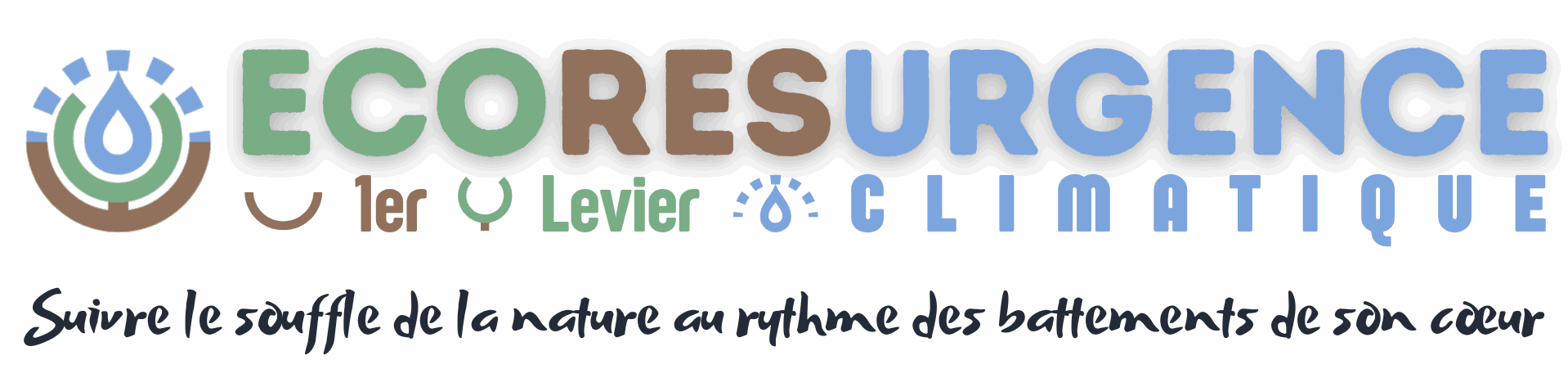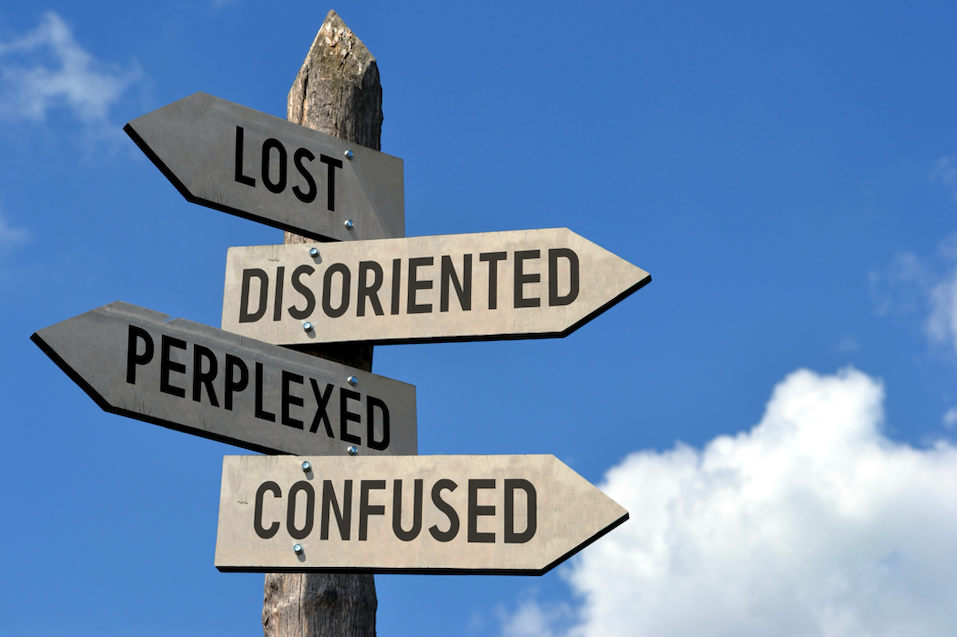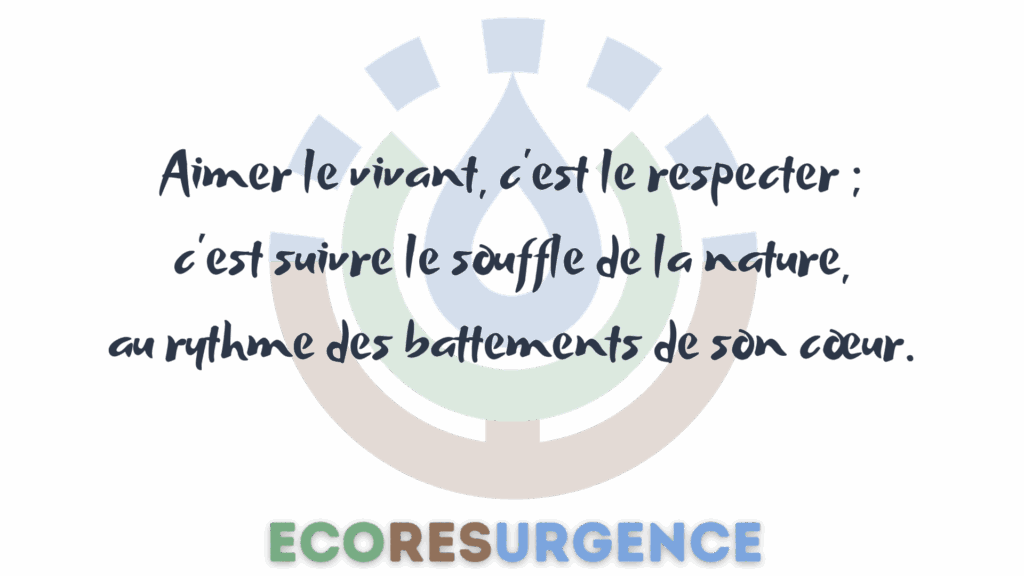UN MOT INEXPLICABLE : bioxénophobie
Les raisons mêmes de son existence m’échappent… Et vous ?
Temps de lecture estimé : 4 minutes
Cliquer sur les termes soulignés en gras dans le texte vous envoie au glossaire, et inversement.
L’intégralité du contenu qui suit n’engage que son unique auteur.
Incompréhension
Je crois bien n’avoir jamais rencontré personne qui porte une haine envers un être vivant, non humain, qui ne soit pas originaire de son aire géographique. Au risque de passer pour un astroxénophobe, ce concept me paraît lunaire…
Cette idée, plutôt saugrenue, est pourtant de plus en plus répandue dans certains milieux écologistes. Et malheureusement pour l’opinion publique, c’est bien connu : la polémique, vêtue d’une morale trompeuse, se propage mieux que la réalité factuelle.
Un peu de recul
Il serait bon de prendre du recul et de questionner l’impact et la légitimité de ce terme pour défendre la libre circulation du vivant.
D’abord, il est très clivant par sa violence et injustement accusateur.
Ensuite, de nombreuses sources (disponibles en ligne) permettent de comprendre que le vivant n’a pas intérêt à circuler librement au gré des transports humains, et que cette migration explosive n’a rien de naturel : c’est une dynamique exponentielle strictement anthropique qui ne respecte aucune règle ou limite écologique, qu’il s’agisse des trames ou des barrières géographiques.
Coévolution, mutualisme interspécifique, cortège biologique, espèces inféodées, relations symbiotiques… autant de termes pour témoigner de relations intimes déstabilisées par les introductions massives d’espèces exotiques. Nous sommes là en pleine artificialisation de nos écosystèmes.
Ce n’est pas pour nous, humains, mais pour l’ensemble de la biodiversité locale que ces plantes sont « mal venues ».
Un certain contraste
On désherbe volontiers les « mauvaises herbes » dans son jardin pour son propre confort, mais extraire des espèces exotiques envahissantes, dans un lieu public ou ailleurs, pour préserver les espèces indigènes ? On appelle cela un « crime écologique »…
Et pourtant, on les a d’abord :
- déracinées de leur écosystème d’origine
- arrachées à leur cortège biologique
- détournées de leur rôle écologique
- transformées génétiquement
- introduites sous un climat étranger à leur phénologie
- implantées pour remplacer les espèces indigènes dont dépendait la faune
Et dans la grande majorité des cas : uniquement pour des raisons esthétiques.
Rappelons que ces plantes viennent avant tout de nos parcs et jardins : des paysages artificiels, transformés principalement pour nous séduire, agrémentés de créations humaines biologiquement inadaptées à la faune.
Je me demande alors : où et quand a eu lieu le point de bascule ?
Ne devrions-nous pas fixer des limites à la domestication du vivant ?
La nature, pour être commandée, doit être obéie.
Francis BACON, scientifique, philosophe, XVIIᵉ
Des solutions ?
Du végétal local
Parce que planter un arbre ne suffit pas : il faut choisir le bon.
Pendant que l’horticulture ornementale privilégie l’apparence à l’appartenance, ne permettant plus à ses variétés de jouer leur rôle écologique, l’OFB, lui, a créé une marque pour répondre aux besoins de l’ensemble de la biodiversité : « Végétal Local ».
Elle repose sur une démarche rigoureuse pour permettre à la flore sauvage et locale (géographiquement distincte) de continuer son brassage génétique naturel. Un processus essentiel pour favoriser sa diversité, clef de son adaptation face au changement climatique, de sa résilience et de sa robustesse.
Dans la vie sauvage repose la sauvegarde du monde.
Henry David THOREAU, philosophe, naturaliste, poète, XIXᵉ
La migration assistée des arbres
« Pour adapter les forêts aux changements climatiques, les équipes de l’ONF ont initié en 2011 une expérience de migration assistée des essences baptisée projet Giono. Depuis maintenant plus de dix ans, des graines de diverses provenances sont sélectionnées dans le Sud de la France pour germer à la pépinière de Guémené- Penfao (Loire-Atlantique), et enfin être plantées en forêt de Verdun (Meuse). »
Dans tout ce que la nature opère,
Jean-Baptiste DE LAMARCK, naturaliste, XVIIIᵉ
elle ne fait rien brusquement.
Pour aller plus loin
Glossaire
Barrière géographique : élément naturel qui limite la dispersion des espèces et favorise l’apparition de diversité spécifique (ex. océan, montagne, désert).
Coévolution : évolution conjointe de deux espèces qui s’influencent réciproquement (ex. plantes et pollinisateurs).
Cortège biologique : ensemble des espèces animales, végétales ou microbiennes associées à une espèce ou un milieu donné.
Espèce exotique envahissante : espèce lointaine introduite par l’humain, qui se propage rapidement et perturbe les écosystèmes locaux.
Espèces inféodée : espèce qui dépend fortement d’un habitat, d’une ressource ou d’une autre espèce (ex. le sphinx des chênes, inféodé au chêne).
Mutualisme interspécifique : interaction durable entre deux espèces différentes où chacune tire un bénéfice réciproque (ex. fourmis et pucerons).
Phénologie : étude des rythmes saisonniers du vivant en lien avec le climat (ex. floraison, migration, chute des feuilles).
Relation symbiotique : interaction durable entre deux espèces, bénéfique pour au moins l’une d’entre elles. (ex. mycorhizes).
Trame écologique : réseau de couloirs et d’espaces naturels connectés, permettant les déplacements et la survie des espèces.
COMMENTAIRES
Cet espace est ouvert pour permettre le débat,
sous réserve de validation des commentaires par la modération.
Les échanges doivent se dérouler dans le respect et la courtoisie.
Nous encourageons le partage d’informations vérifiables en ligne.
Les arguments sans sources seront publiés s’ils sont jugés pertinents
après analyse par notre réseau professionnel, un délai est alors à prévoir.
Les discours purement idéologiques ne seront pas retenus.